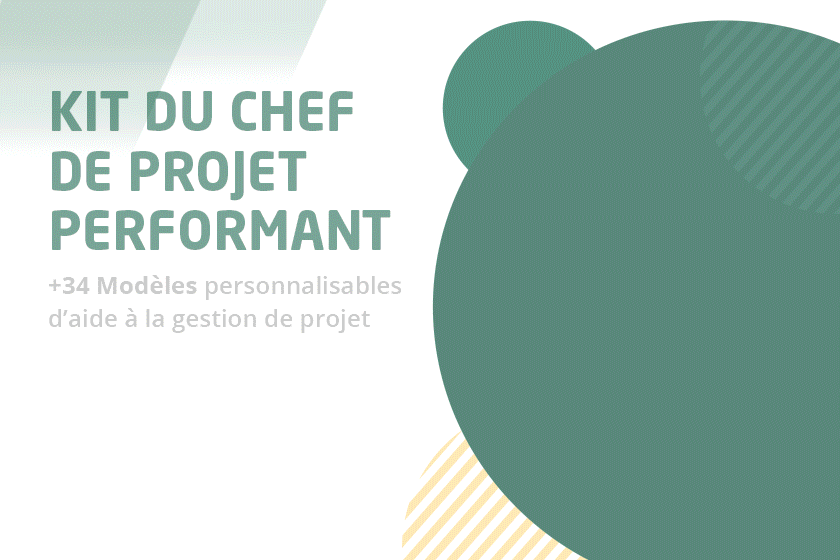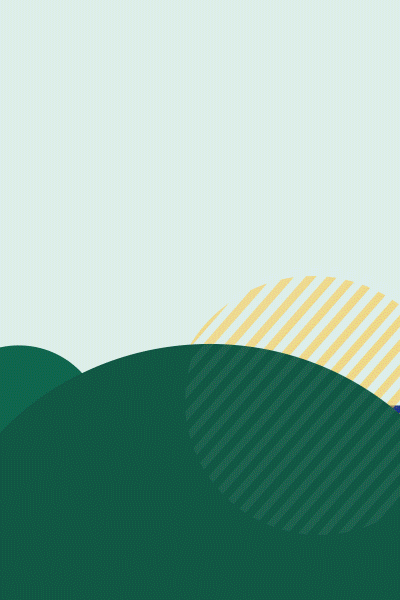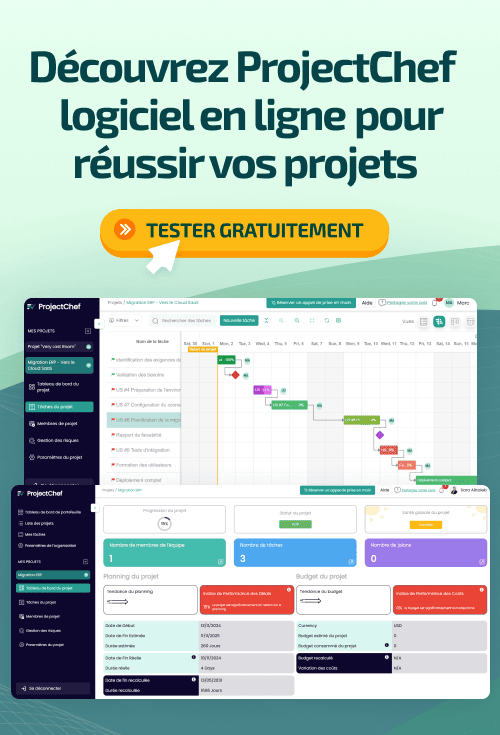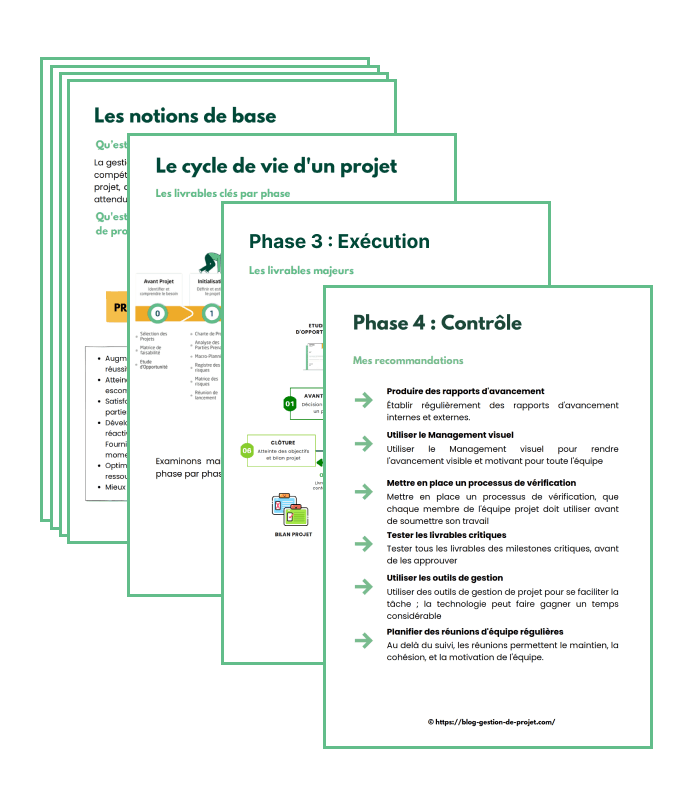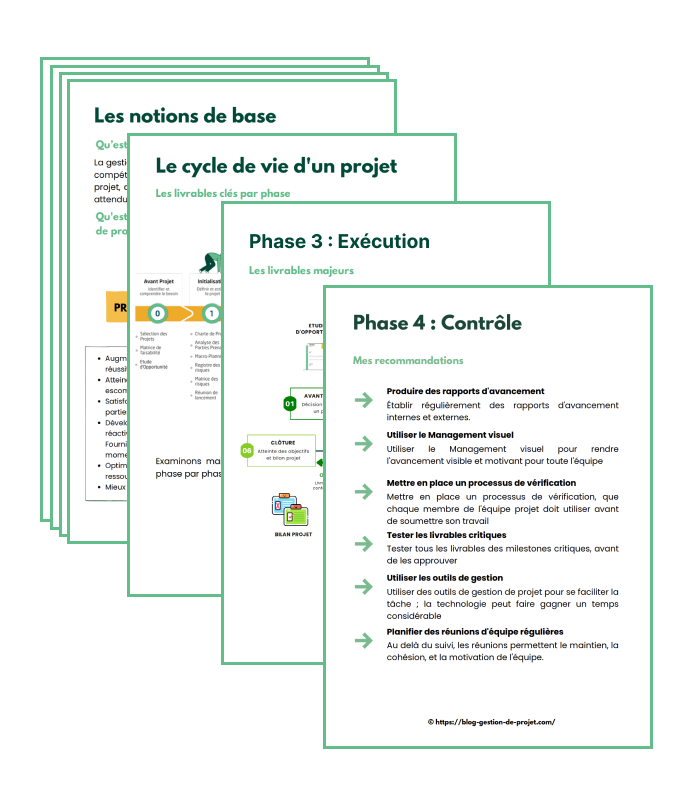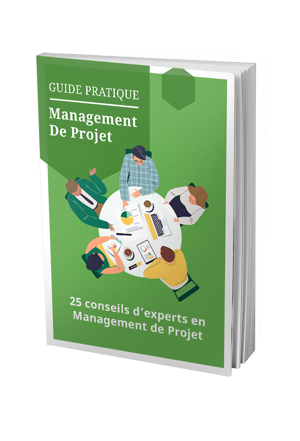Un projet peut être rapidement dispersé avec toutes ses composantes, et pourtant il s’agit d’un résultat unique.
Une bonne intégration de projet permet de rassembler et d’aligner toutes les composantes. Elle aligne la vision, les efforts, et les nombreuses décisions.
Sans elle, le planning dérive, le budget explose et la valeur se perd.
Le chef de projet a besoin de cette vue d’ensemble et il en est le garant pour assurer le succès du projet.
Si cette intégration n’est pas faite correctement, il y a un grand risque que les décisions perdent en cohérence.
En effet, le projet doit être cohérent et son succès sera dépendant de la réussite de ces objectifs.
Cela ne peut se faire que si le projet est vu dans son ensemble et pas comme la somme de plusieurs éléments.
Pourquoi l’intégration est indispensable dans un projet
L’intégration est indispensable, car un projet n’est jamais homogène par nature.
Un projet implique des parties prenantes aux attentes diverses, des domaines techniques distincts, des contraintes multiples.
Pour rendre cela pilotable, il faut décomposer.
Dans un projet, les parties prenantes, les domaines peuvent être variés, complexes ou grands. Il est alors important de le décomposer en suivant un WBS (Work Breakdown Structure) par exemple.
Mais, ce n’est pas le cas unique.
La décomposition du projet peut suivre le RBS (Resource Breakdown Structure) ou le PBS (Product Breakdown structure).
Lorsque la méthodologie de gestion de projet est le cycle en V, il y a bien une étape de test d’intégration.
Cela permet de s’assurer que le projet dans sa globalité répond bien aux exigences formulées.
En effet, il est possible lors des tests unitaires de chaque élément du projet que chaque élément testé soit validé, mais que lors du test d’intégration, il y ait blocage.
Le test d’intégration intervient alors comme une étape clé :
Il consiste à assembler plusieurs modules ou composants entre eux.
Ce qui peut se produire malgré des tests unitaires « au vert » :
- un format de données attendu par l’un ne correspond pas à celui généré par l’autre ;
- un décalage dans les appels de fonctions fait planter l’enchaînement ;
- une latence réseau non prévue perturbe une synchronisation ;
- des règles métiers contradictoires génèrent des anomalies au moment du regroupement.
On peut prendre aussi l’exemple d’une voiture.
Si on la décompose en PBS par l’usinage de chaque élément de la voiture comme les roues, le moteur, le frein, ou encore le guidon.
- Dans un premier temps, on produit chaque élément séparément et on vérifie qu’il répond bien à toutes les exigences et conformités.
- Puis lors de l’assemblage de la voiture, on vérifie que tous les éléments font fonctionner correctement la voiture, qu’ils sont à la bonne place, reliés correctement entre eux.
- On fait ensuite les tests sur la voiture dans son entièreté.
Cela est pareil pour un avion, une fusée, un projet de logiciel informatique ou tout autre projet.
Aspects à intégrer et comment les articuler
Voici tous les types d’éléments :
- Les besoins des parties prenantes
- Les contraintes (budgétaires, temporelles ou réglementaires)
- Les livrables
- Les processus de gestion
- Les équipes
Il peut exister plusieurs façons d’intégrer, soit de manière incrémentale par phase, soit de manière continue avec une mise à jour à chaque ajout.
Il est indispensable de relier toutes les pièces du puzzle pour avoir l’image complète.
Deux approches sont possibles :
- Chaque bloc du projet peut être intégré progressivement dans le but de verrouiller l’intégration au fur et à mesure. Cela s’applique souvent en méthodologie en cycle en V. Par exemple, dans un chantier, chaque étage est livré et testé indépendamment.
- Chaque ajout ou évolution est intégré en temps réel. Plus adapté aux méthodologies agiles. Dans la méthodologie agile, l’intégration est continue à chaque Sprint.
Dans cet article, nous allons partager les principes et pratiques pour mener à bien cette intégration en évitant les pièges classiques.
6 domaines clés de l’intégration (avec exemples et conseils)
Une bonne intégration, c’est un ensemble de processus dès le début du projet qui permette de revenir au projet dans son ensemble.
Je vais m’appuyer sur les processus comme décrit dans le PMBOK (Project Management Body of Knowledge).
1) Rédaction d’une charte de projet complète et partagée
C’est une étape importante qui peut être négligée au profit d’un contrat ou d’une réunion de Kick-off.
Pourtant, elle est pertinente et sera un véritable garde-fou surtout si la complexité et le nombre des composants est élevé.
C’est le document de référence qui décrit tous les composants du projet. Toutes les parties prenantes ont la même vision du projet. Ils connaissent tous le périmètre et les jalons.
C’est aussi le moment où l’on étudie le projet, d’un point de vue macro, où le découpage est esquissé et où les divergences peuvent être adressées.
Par exemple :
Dans un projet de site e-commerce, la problématique est d’équilibrer entre le besoin de visuels et designs élaborés contre un souci de budget ou rentabilité.
Quelle est la bonne proportion de budget à allouer au design sans être en perte. Bien mettre en avant 3 KPI que toutes les parties prenantes peuvent suivre et consulter.
Cela peut être :
- un taux de conversion supérieur à 3%
- un NPS (Net Promoter Score) supérieur à 6
- ou un ROI de 15%.
Enfin, cette étape permet de clarifier les règles du jeu : le rôle du chef de projet, son périmètre d’autorité, les circuits de décision, ainsi que les modalités de collaboration entre les différents acteurs du projet.
À éviter absolument :
Un chef de projet qui remplit le template seul dans son coin !
La Charte devient un simple document administratif et pas un contrat sur lequel chacun s’engage.
2) Définition et pilotage du Plan de Management de Projet
Avec un projet décomposé, il est important d’avoir un document qui explique et détaille l’architecture du projet.
Ce document ainsi que le plan de projet avec toutes ces composantes, où tout est détaillé au niveau du périmètre, des coûts, de la communication, de la qualité et des ressources.
Ce document peut être assez conséquent, mais le projet comporte de nombreux composants, parties prenantes, exigences.
C’est aussi là que le versioning ainsi que ses processus sont expliqués.
Il est aussi impératif d’avoir une version simplifiée claire en une page accessible à tous pour voir d’un œil le projet dans son ensemble.
Chaque projet a besoin de son plan de projet adapté à son contexte, son planning et ses exigences.
3) Gestion du travail, du projet et des livrables
Après avoir bien établi la charte de projet, le plan de projet et le planning, c’est le moment d’exécuter les tâches suivant les plans, de les distribuer.
Il est primordial de suivre l’avancement en continu et de gérer les livrables.
On peut utiliser pour cela des Daily ou weekly flow review pour se concentrer sur les blocages, s’assurant ainsi de leur élimination et de la bonne progression du projet.
À chaque fois, qu’un livrable est prêt, il faut qu’il soit validé selon ses critères d’acceptance ou le « Definition of Done ».
Exemple :
Pendant l’implémentation d’un ERP, pour une PME de 200 personnes avec une équipe de 5 de la direction des Systèmes d’information sur le projet.
On remarque une faible visibilité avec un grand nombre de bugs non corrigés à cause de silos. Les correctifs s'empilent sans ordre de priorité clair.
L’équipe était noyée et ne savait où donner de la tête.
Le chef de projet a décidé de mettre en place deux outils agiles qui ont permis de clarifier, d’identifier plus vite les priorités et les blocages.
Il s’agit :
- d’un Kanban visuel avec les colonnes : « à qualifier » ; « prêt » ; « en cours » ; « à valider » et « terminé »
- d’une Burndown Chart, projetée quotidiennement sur écran pour suivre la dette de bug !
Ce qui a été observé est une baisse conséquente des anomalies critiques (-30%), un temps de résolution moyen diminué significativement (divisé par 2) et une priorisation claire et partagée.
4) Surveillance
S’assurer à tout moment qu’il n’y ait pas de déviation est primordial pour un projet.
Il faut mettre en place les outils adéquats permettant de faire circuler l’information de manière lisible et actionnable.
Un tableau de bord à 3 horizons rend cela :
- Opérationnel : qui permet de suivre au jour le jour l’avancement des tâches, les points de blocage ou encore les charges consommées et leurs dérives par rapport aux charges planifiées
- Tactique : pour piloter la trajectoire, anticiper les écarts et adapter le cas échéant.
- Stratégique : s’assurant que le projet est toujours aligné avec la stratégie de l’entreprise, qu’il produit de la valeur et les bénéfices
Il est important d’utiliser une méthode comme l’analyse de la valeur acquise pour comparer ce qui a été accompli.
Utilisez ces trois indicateurs pour suivre au mieux le projet :
- CPI (Cost Performance Index)
- SPI (Schedule Performance Index)
- EAC (Estimate At Completion)
Ces 3 indicateurs permettent dans l’ordre de suivre si le projet est en dessous ou au-dessus du budget, s’il est dans les délais et la nouvelle estimation du budget avec les informations du moment.
Exemple :
Prenons l’exemple d’un projet de construction de data center, avec un budget de 16 millions d’euros.
À mi-parcours, le tableau de bord affiche un CPI (Cost Performance Index) de 0,85.
Ce chiffre indique que les coûts réels dépassent les prévisions. Cela signifie que le projet est hors budget.
En analysant les données plus finement, le PMO identifie deux causes principales :
- un volume important de factures émises de manière anticipée,
- des commandes de matériel mal calibrées.
Ceci a entraîné une gestion sous-optimale des approvisionnements.
Il faut alors faire des actions correctives et rattraper le retard.
Le PMO arrive à redresser la barre deux mois plus tard avec un nouveau CPI de 0,98.
5) Maîtrise des changements
Il n’y a pas de projet sans changement, le moindre changement va affecter plusieurs composantes du projet, sa maîtrise fait partie des bonnes pratiques d’intégration.
À chaque changement, il faudra veiller à bien implémenter la version selon ce qui a été défini dans le plan de projet. Il faut aussi s’assurer de l’impact et des corrélations.
Il faut donc s’assurer de bien traiter les demandes de changement, en évaluer les impacts et décider
Il ne faut pas confondre « petite amélioration » et « changement gratuit ».
Même un petit ajustement peut impacter plusieurs axes comme la sécurité ou la qualité.
6) Clôture du projet et gestion des connaissances
Lorsqu’on arrive à la clôture, il est important de remettre le produit, libérer les ressources et archiver.
Voici les bonnes pratiques de clôture :
- Checklist de clôture
- Cérémonie de reconnaissance
Il ne faut absolument pas passer à la suite sans ces deux éléments.
En ce qui concerne la gestion des connaissances, c’est une partie importante qui permet de s’assurer en début d’avoir toutes les informations et de s’appuyer sur les précédentes expériences et projets.
Consulter ce qui est présent sur l’extranet et se tourner vers des chefs de projet expérimentés.
Conseils pratiques et erreurs à éviter
Faire cette intégration n’est pas sans danger, voici quelques bonnes pratiques à retenir :
- Cartographier les dépendances critiques dès le lancement et les impacts de changements
- Favoriser la cohérence des décisions tout au long du projet
- Mener des revues régulières pour garder une vue d’ensemble
- Documenter ce qui est décidé, pourquoi cela l’a été, et ce que cela implique concrètement
Quelques erreurs courantes sont :
- Manquer de clarté sur les priorités, les responsabilités ou les objectifs
- Sous-estimer des dépendances entre les différentes composantes du projet, et penser qu’elles peuvent avancer séparément sans coordination
- Cloisonner les parties prenantes en limitant les échanges ou en travaillant en silos
Conclusion
L’intégration est une posture globale permettant de garder le cap malgré la complexité. Elle permet de transformer un ensemble de composants en une création cohérente.
Elle agit comme un fil rouge et donne du sens à l’action quotidienne.
Quand elle est négligée, les projets deviennent fragiles et les résultats se diluent.
Faites, dès aujourd’hui, le point sur votre projet : est-ce que l’image d’ensemble est nette et tout est bien relié.
3 actions à mener, si ce n’est pas déjà fait :
- Faites l’autodiagnostic d’intégration : quelles sont les faiblesses du projet : charte, changement, communication, etc.
- Choisissez un outil impactant rapidement : un processus de changement, un statut du projet en une page ou le partage de connaissance via des réunions.
- Capitaliser en partageant vos retours d’expérience au prochain comité, par exemple.
En maîtrisant ces interactions, vous sécurisez durablement vos résultats.